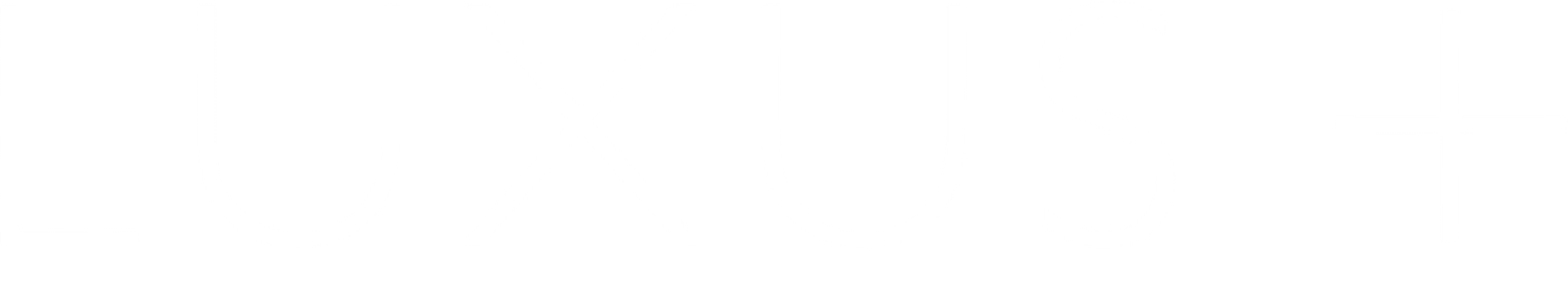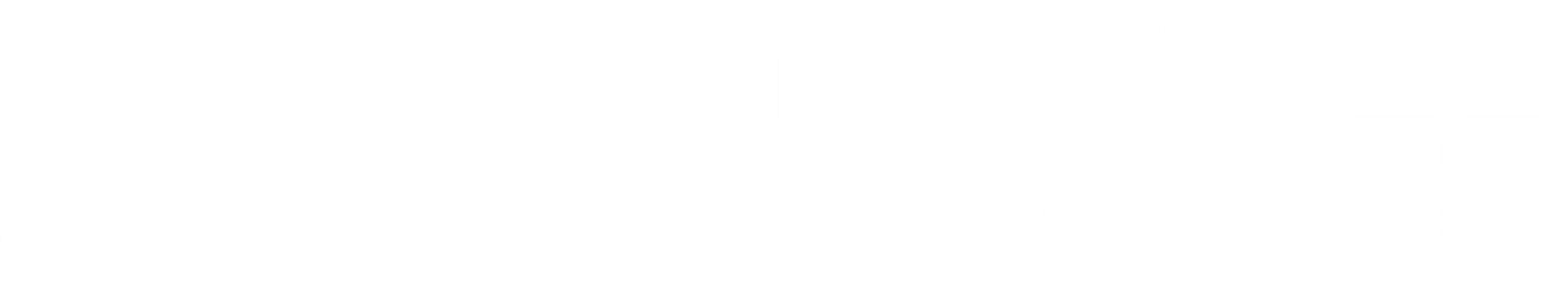A l’heure où le soleil darde ses derniers rayons estivaux et où certains peuvent encore se prévaloir de leur peau dorée de retour au bureau, voici une plongée dans la petite histoire du bronzage. Loin d’être un geste anodin, se dorer la pilule sur son lieu de villégiature est autant un acte social que statutaire. La pratique devenue socialement acceptable en Occident est passé d’une connotation paysanne au mythe doré de la modernité.
« Le bronzage est une invention culturelle du XXᵉ siècle », rappelle l’historien Pascal Ory dans son essai L’invention du bronzage devenu référence. Longtemps associé au labeur et à l’infériorité sociale, le bronzage est devenu au XXᵉ siècle un symbole de liberté, de modernité et de loisirs. Des dieux solaires de l’Égypte aux plages de Saint-Tropez, des aristocrates poudrés aux stars hollywoodiennes, l’évolution de la peau hâlée illustre un basculement culturel majeur. Derrière l’apparente légèreté estivale, il révèle des enjeux sociaux, politiques et esthétiques, éclairant nos rapports au corps, au pouvoir et au désir.
Le soleil, entre divinité et danger dans l’Antiquité
Dans les civilisations anciennes, le soleil n’était pas seulement source de lumière, mais d’abord une divinité. En Égypte, Rê – le Dieu-Soleil – incarnait la puissance vitale et les pharaons, représentés avec une peau dorée, associaient ce teint lumineux à la prospérité. Ce hâle n’était pas un bronzage volontaire, mais un symbole religieux.

Chez les Grecs et les Romains, l’idéal restait paradoxal : les dieux comme Apollon étaient dorés et rayonnants, mais les élites valorisaient les peaux claires, protégées du soleil grâce à des voiles ou des onguents. L’historien Jean-Claude Bologne rappelle que, pour les patriciens romains, « le teint pâle signifiait l’oisiveté, la disponibilité au loisir cultivé, par opposition au hâle des esclaves et des soldats ».
Cliquez ici pour lire l’article en entier sur Luxus Magazine
Photo à la Une : Unsplash